Genealexis
Histoires d'hier et d'aujourd'hui...
1008 ans de grâces à Valenciennes
- Écrit par Alexis
Source pour le texte: "Brochure Notre-Dame du Saint-Cordon".
Alors que la cité du Hainaut était victime d'une terrible épidémie de peste, Bertholin, un pieux ermite du monastère de Fontenelle, près de Maing, implora la Vierge Marie d'intervenir en faveur des valenciennois. Celle-ci lui apparut et lui demanda de rassembler les habitants sur les remparts de la cité pendant la nuit du 7 au 8 septembre 1008. C'est au cours de cette nuit que Marie apparut escortée de ses anges et leur confia un fuseau de lin avec lequel ils tressèrent un cordon écarlate qu'ils déposèrent autour de la cité qui fut sauvée de la peste. En reconnaissance, les échevins de la cité promirent à la Vierge de refaire chaque année le "tour du Saint Cordon" en portant la précieuse relique autour de la ville. Ce qui fut fait sans interruption jusqu'à nos jours. Abritée en la vénérable collégiale Notre Dame la Grande, la relique du Saint Cordon - tout comme l'édifice - disparut à la révolution. Depuis 1804, c'est une statue de 125 kg qui est portée par 6 personnes sur les 147 km de la procession, une des plus importantes du Nord de l'Europe. La basilique Notre-Dame, datant de 1864, est en cours de restauration. Dans l'attente de sa réouverture, la statue de Notre Dame est accueillie en l'église Saint-Gery de Valenciennes.

Notre-Dame du Saint-Cordon
Depuis les origines, l'organisation du pèlerinage et la protection de la statue ont été confiées à la confrérie des Royés, nom tirant son origine du costume "rayé" des membres. Aujourd'hui, 40 hommes, avec leur bâton garni de buis, assurent le bon ordre de la procession et la garde la statue durant la neuvaine.

Notre-Dame du Saint-Cordon
(source: www.pelerinagesdefrance.fr)
L'histoire du cresson
- Écrit par Alexis
Aujourd’hui, je vais faire appel au gourmand qui est en vous, celui qui aime les chocolats fourrés à la menthe, les éclairs au café, les africains (une spécialité valenciennoise proche du suisse), celui qui aime les crêpes au chocolat sur lesquelles on dépose des rondelles de banane et une boule de glace à la vanille, et que l’on mange accompagné d’un verre de Kwak ou d’une tasse de chocolat chaud, en vous proposant un article sur le cresson. Je sais que l’on fait mieux comme sujet, mais grâce à moi, vous allez pouvoir briller en société quand vos amis lanceront un débat enflammé sur le cresson. (Quoi ? Vous ne faites pas ça chez vous ?)
Laissez-moi vous raconter.
Nous sommes à la fin du XVIIe siècle, dans les cuisines de Versailles, Louis XIV, le Roi Soleil, brille de toute sa splendeur. Il imprime sa marque sur les modes, sur l’art, sur le théâtre, sur les jardins, sur l’architecture et bien sûr, on festoie en grande pompe. Mais quelques problèmes de digestion obligent parfois le Roi à être plus raisonnable et à suivre les conseils de ses médecins qui lui recommandent de commencer son repas par trois ou quatre assiettées d'un "potage de santé" à base de cresson.
Un article paru dans la revue Rustica au milieu des années 90 rapporte que le cresson était « déjà fort apprécié des Grecs et des Romains, cette plante sauvage originaire du Moyen-Orient ne tarda pas à faire partie du repas des habitants de l’Île-de-France. Au moyen-âge, il poussait dans les fossés, au bord des ruisseaux ou dans des baquets percés, remplis de terre et mis en eau. Certains le désignaient comme une plante aux vertus médicinales. On surnommait le cresson, qui est riche en sels minéraux et en vitamines, « la santé du corps ». La consommation devenant de plus en plus importante, on passa de l’état de cueillette à celui de culture. Celle-ci fut mise au point en Allemagne.

La cueillette du cresson dans l'Eure
C’est seulement à partir de 1810 que la France s’intéressa de plus près à ces méthodes de production. Un certain M. CARDON, maraîcher originaire de Saint-Léonard, près de Senlis dans l’Oise, fit venir quelques ouvriers prussiens afin de développer la technique des cressonnières artificielles en eau courante. Bien vite, la région s’imposa pour la qualité de sa production et devint la spécialiste de cette culture. Au milieu des années 90, c’est l’Essonne qui avait pris le relais de cette tradition culturale avec 60 fosses à cresson dit « de fontaine ». Le cresson y était toujours cueilli à la main, tous les vingt-cinq jours, de mars à l’octobre, ce qui demandait beaucoup de savoir-faire et de patience. »
Et voilà, grâce à moi, vous êtes devenu un pro de l’histoire du cresson.
Pourquoi le muguet est-il symbole de bonheur ?
- Écrit par Alexis
Je vous propose un petit document qui raconte comment le muguet est devenu un porte bonheur.
(source: Revue Horizons n°4 de mai 2014).
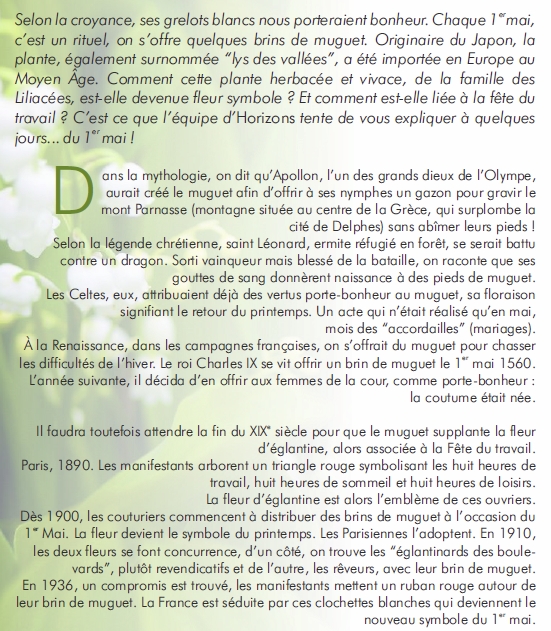
Nos ancêtres... Les Nerviens.
- Écrit par Alexis
Dans tout cet article, il faut prendre « belge » au sens « latin » du terme. Il désigne les populations celtes qui occupaient la Gaule Belgique, une région globalement située entre la Seine et le Rhin.

Carte des peuples gaulois
(Cliquez pour agrandir)
Tacite, un auteur latin né en 58 et décédé en 120, disait des belges qu’ils « affectionnaient hautement leur origine germanique, disant que ce sang noble les séparait de toute similitude [avec les Gaulois] et de la paresse gauloise ». Cette origine déjà rapportée par Strabon et César, a été confirmée par les recherches archéologiques qui tendent à prouver que des mouvements ethniques au IIIe siècle avant JC sont à l’origine de la formation des peuples connus sous le nom de belge durant l’antiquité.
Parmi les nombreux peuples de la « Belgica », on compte les Eburons, les Atrebates, les Viromanduens, les Ambiens et enfin les Nerviens, réputés pour être, selon César, le plus farouche de tous les peuples belges. Il indique par exemple que « les marchands n’avaient aucun accès auprès d’eux ; ils ne souffraient pas que l’on introduisit chez eux du vin ou quelques autres produit de luxe, estimant que cela amollissait leurs âmes et détendait les ressorts de leur courage ; c’étaient des hommes rudes et d’une grande valeur guerrière » qui érigeaient des défenses de haies, sûrement des bocage, pour défendre leur territoire.
A la fin de l’année 57 avant J.C., sous la conduite des Nerviens, presque aussi puissants que les Bellovaques, un peuple gaulois originaire de l’Oise, les belges des Flandres et du bord du Rhin opposent aux armées de César une résistance farouche lors d’une bataille qui leurs vaut la plus longue description de la part de César. Les Nerviens, sous la conduite de leur « Chef Suprême » Boduognatos, perdent 300 de leurs 600 sénateurs et la quasi-totalité de leurs guerriers : plus de 150000 sont morts ou ont fuit. Boduognatos meurt pendant la bataille. Par sagesse, pour éviter de les laisser démunis face aux agressions germaines, César conclut la paix avec les belges sans rien exiger d’autres. C’est une période qui est restée dans l’histoire sous le nom de Bataille du Sabis (La Selle, affluent de l’Escaut).
Après sa campagne contre les bretons (Grande-Bretagne) de 55 avant JC, Jules César est de retour en Gaule. Il fait campagne contre les Morins et les Ménapes, puis prend ses quartiers d’hiver chez les belges.
Pendant l’hiver 54 avant J. C, Le Hainaut est conquis par César au prix d’un siège de 7 jours et de la trahison de Vertigo, un aristocrate Nervien acquis à la cause romaine. Très vite, la région est latinisée voit son réseau de piste remplacé par 7 voies traversant l’Escaut : « Pons Scalis » (Escaupont) et 1 passant par Famars « Fanum Martis » où un camp situé au Mont-Houy domine les premières huttes valenciennoises. Les Nerviens se joignent à l’entreprise d’Ambiorix et assiègent Cicéron. Ils sont battus par César, venu au secours de son lieutenant.

Les fouilles à Famars
(source: INRAP)
A la fin de l’hiver 53 avant JC, César rassemble ses troupes les plus proches (4 légions) et marche sur le pays des Nerviens, qui préparent de nouveau une entrée en guerre, sans leur laisser le temps de réagir. Il vole le bétail qu’il offre à ses soldats et dévaste la campagne nervienne. Les Nerviens sont obligés de se soumettre et doivent livrer des otages à Rome. L’année suivante, affaiblis, ils participent toutefois à la révolte de Vercingétorix comme Jules César lors de la Bataille d’Alésia en envoyant 5000 hommes.
Les Nerviens restent fidèles à Rome pendant la révolte du chef batave Civilis (68 et 69 après J.C.). Fidèle auxiliaire des armées romaines, il est soupçonné à tort de haute trahison avec son frère Paulus. Ce dernier est exécuté, alors que Civilis bénéficie de l'avènement de Galba qui le libère. II provoque en 69 une révolte de son peuple (la Révolte des Bataves) à la suite de laquelle il est bientôt rejoint par des Germains et une partie de la Gaule conduite par Julius Sabinus. Après des victoires dont la prise de Mayence il fut vaincu à Trèves par le général romain Petilius Cerialis, traita avec les Romains et devint leur allié en 70.
En 291 après JC, la région est repeuplée par des prisonniers Francs sous l’ordre de Maximien Hercule, suite aux incursions ennemies sur l’Empire. Il s’agit surtout de l’établissement des Chamaves et des Frisons, deux peuples germains, dans la Batavie (Pays-Bas actuels).
Au IVe siècle après Jésus-Christ, l’Empire Romain est devenu un empire chrétien depuis la liberté des cultes décidée par Constantin (en 313), l’interdiction des cultes païens et la promotion de la religion chrétienne en religion d’état par Théodose (en 394). C’est à cette période que Saint-Martin et son disciple Victrice évangélisent le Pagus Fanomartensis qui va de Famars à la Sambre et installent à Bavay un évêque nommé Superior.
Vers 432, les villes de la Belgique Seconde sont sans défense, car Aetius, le général romain chargé de la défense de la Gaule, a eu besoin des troupes pour lutter contre les Burgondes, les Alains, les Francs rhénans, les révoltes antifiscales et les Wisigoths. Clodion profite de l’occasion pour monter une expédition et s’empare de Tournai, Cambrai et Arras pour s’y installer pour quelques années. En 448, Aetius décide de punir les francs pour avoir annexé des territoires sans aucune autorisation. Il attaque Clodion à Helena (près d’Arras) pendant le mariage d’un membre important de son armée. Aetius sait très bien qu’il n’a pas les moyens logistiques de maintenir l’ordre dans les territoires occupés illégalement par Clodion. Il propose donc à celui-ci de renégocier le fœdus, le traité d'alliance de 342 qui fait des Francs saliens des fédérés combattant pour Rome et autorise Clodion à rester sur les territoires qu'ils ont déjà conquis en tant que « fédérés ». Clodion installe sa capitale à Tournai. A la mort de ce dernier, et comme le veut la coutume franque, son royaume est divisé entre ses 3 fils : Mérovée reçoit la ville de Tournai, son second fils reçoit Cambrai et enfin le dernier Tongres. Mais ça, c’est une autre histoire !

Clodion Le Chevelu
Par ce que je sais que vous êtes des petits curieux avides d’histoire, je vous donnerai prochainement la liste des sources qui ont servi à l’écriture de cet article. Bonne découverte !


Lire la suite...